 Renoir
Renoir
Chie Hayakawa – 2025
Impossible de ne pas penser à Déménagement de Shinji Somai en voyant le récent Renoir de Chie Hayakawa. On y est plongé dans le quotidien et la psyché d’une petite fille, Fuki, qui doit composer avec une situation familiale douloureuse. Dans déménagement, les parents se séparaient, dans Renoir, ils vont se séparer tout simplement parce que le père, atteint d’un cancer inguérissable, va bientôt disparaître. Ajoutons à cela que la fillette présente à peu près la même coupe de cheveux, la même chemise verte flashy, et qu’Hayakawa a décidé de situer son histoire à la fin des années 80 (Déménagement est au début des années 90) et l’on se dit que ça fit tout de même beaucoup de ressemblances. Il n’est pas impossible que la réalisatrice, consciente d’inévitables rapprochements que l’on ferait entre son histoire et celle d’un des chefs-d’œuvre de Somai, ait peut-être joué la carte de l’hommage pour couper court à d’éventuels reproches de plagiat.
Dans tous les cas, le film se démarque dans la manière de restituer le mal-être de Fuki. Car il ne s’agit ici pas tant de le crier pour protester, avec peut-être le désir inconscient que les parents se rabibochent. Fuki voit bien que son père est au plus mal (cela fait d’ailleurs bizarre de voir Lily Franky, acteur solaire associé à une bonne humeur familiale – on songe à Tel Père, Tel Fils – jouer un personnage en phase terminale), elle entend les paroles sans espoir des collègues de travail venus le voir à l’hôpital et au bout du compte, elle a assimilé le fait que son père n’est plus là pour très longtemps. Mais la grande question est : comment réagir face à cela ? Pleurer ? Être malheureuse ? Ou au contraire se plonger dans sa vie quotidienne ? Voir et jouer avec ses amies ? Mais dans ce cas, ne serait-ce pas le signe d’une indigne insensibilité ? En fait, Fuki est dans le cirage, un cirage émotionnel, tout comme le spectateur durant la première heure qui ne sait pas trop comment prendre l’histoire. Hayakawa empile des réactions, des situations, au spectateur de se faire une idée. Fuki ne l’aidera pas car, contrairement à son homologue dans Déménagement, elle ne parle que très peu et il faut dès lors décoder ses actions. Ainsi, quand elle revient de l’hôpital, tenant par la main en marchant son père qui a du mal à se déplacer, elle le lâche aussitôt pour faire mine d’observer quelque chose au sol, voyant que des camarades de classe s’approchent. On comprend qu’elle a honte d’être vue en compagnie de ce père pitoyable. Mais dans la scène suivante, sur une aire de loisirs où de jeunes adultes se moquent de son père endormi sur un banc, elle réagit et n’hésite pas à botter le cul (littéralement) à l’un des fâcheux. Si elle peut avoir honte de son père, cela ne vas pas jusqu’au point d’accepter qu’on l’humilie.
Car au fond d’elle-même, il y a bien sûr l’amour et la conscience d’une lourde perte. Et c’est tout le crédit d’Hayakawa de ne pas avoir cherché à surligner des effets faisant dans le pathos. Elle préfère plonger le spectateur dans une multitude d’actions ou de motifs. Ainsi celui du cheval, animal que Fuki dessine dans son cahier et dont elle imite (joliment) le hennissement. Il est aussi associé à l’hippodrome… dans lequel son père a l’habitude d’aller. Ainsi son refuge dans l’imagination, que se soit en compagnie de son amie Chihiro (prénom miyazakesque qui annonce la couleur), ou dans les rédactions scolaires ou même son journal intime. Ainsi ses incursions en cachette dans le téléphone rose pour parler et rencontrer un homme — plutôt un jeune homme, en pleine santé, sorte de père de substitution idéal (on s’accroche aux accoudoirs quand on voit Fuki accepter son rendez-vous et se rendre chez lui). Ou encore quand, voyant que sa fille est fascinée par une reproduction de « La Petite Irène » de Renoir qu’un marchand vend dans le hall de l’hôpital, son père décide de l’acheter, et donc de lui en faire cadeau puisque lui n’aura pas le temps d’en profiter. Ce cadeau, au-delà des images mentales de son père, sera le moyen pour Fuki de garder un lien symbolique avec son père.
Bref, après un Plan 75 intéressant mais qui ne m’avait pas non plus embarqué – en dépit de la présence de Chieko Baisho – Hayakawa fournit un deuxième long métrage bien plus abouti. Une réalisatrice clairement à suivre.
8/10






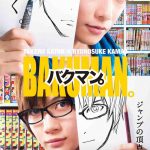


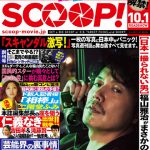
![Directeur couil[censuré] et actrices poil[censuré] de la [censuré]](https://bullesdejapon.fr/wp-content/uploads/2019/08/naked-director-poster-1-e1565943548629-150x150.jpg)







